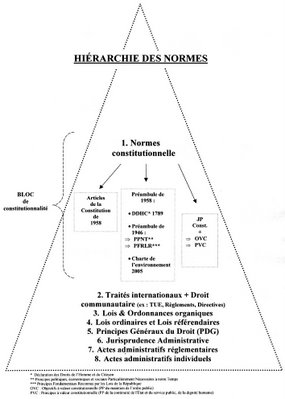Service public et Eau

Tous les élus franciliens cherchent la parade à l'envolée de la facture d'eau des usagers. Depuis plusieurs années, la consommation d'eau dans la région a baissé plus fortement en Ile-de-France que dans le reste du pays en raison de la désindustrialisation et de la diminution des fuites sur les réseaux. Cette baisse des recettes, mal anticipée, a conduit les opérateurs à augmenter le prix du mètre cube d'eau alors que, dans le même temps, de nouvelles normes d'assainissement sont venues accroître leurs charges.
A Paris, en 2007, la facture d'eau a augmenté de plus de 9 %, soit, en moyenne, 30 euros de plus par ménage. Dans le total, la part qui correspond à la production et à la distribution a flambé de 260 % depuis 1980. Or, cette composante de la facture représente 38 % du coût de l'eau.
Si la production de l'eau a toujours été gérée par une société d'économie mixte municipale, à Paris, sa distribution a fait l'objet en 1985 d'un contrat d'affermage signé par Jacques Chirac, le maire de l'époque, avec la Compagnie des eaux de Paris (filiale de Veolia) pour la rive droite, et avec la société Eau et Force (groupe Suez), pour la rive gauche.
La chambre régionale des comptes et l'Inspection générale de la Ville ont, en 2000 et 2001, critiqué les clauses de ces contrats : elles ont permis aux opérateurs de faire fructifier leurs marges par des jeux de trésorerie au lieu de les réinvestir dans le réseau.
M. Delanoë avait promis durant la dernière campagne municipale de mettre la distribution de l'eau en régie. Les études menées par la Mairie ont mis en évidence l'intérêt financier, pour la collectivité, de confier à un seul établissement public à la fois la production et la distribution.
Ce passage en régie a été voté lundi. Il devrait permettre à la Ville de récupérer 30 millions d'euros par an par rapport à la précédente gestion. La moitié de cette somme correspond aux marges que Veolia et Suez dégageaient chaque année au minimum. "La Ville continuera de dégager des bénéfices mais au lieu de les distribuer à des actionnaires comme le faisaient les groupes privés, nous allons les réinjecter dans le système", justifie Anne Le Strat, adjointe (app. PS) chargée de l'eau à la Mairie. Les 15 millions restants résultent d'un régime fiscal plus favorable pour le système en régie. Mais même si la facturation par la Ville se stabilise, la note globale pour l'usager ne diminuera que s'il consomme moins.
Les Parisiens payent l'eau moins cher que les 4 millions d'habitants des 144 communes franciliennes regroupées au sein du Sedif. Le 11 décembre, André Santini, président du Sedif, maire (Nouveau Centre) d'Issy-les-Moulineaux et secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, proposera aux élus de ce syndicat de maintenir un système de délégation de service public à un opérateur privé. Il devrait donner lieu à un appel d'offres international. Mais les maires de gauche, Dominique Voynet (Verts) à Montreuil, ou Philippe Kaltenbach (PS) à Clamart, n'en devraient pas moins défendre une fois de plus à cette occasion le passage à une gestion publique.
M. Santini leur oppose une autre solution : "la mutualisation des ressources de production" entre opérateurs en l'Ile-de-France. Le 4 décembre, il réunira la ville de Paris et trois autres syndicats intercommunaux de l'eau dans la région pour débattre. UFC-Que choisir défend aussi l'idée d'un Grand Paris de l'eau qui permettrait des économies d'échelle et une réduction de la capacité de production de l'eau, aujourd'hui excédentaire par rapport aux besoins.
"La mutualisation des ressources est une idée que nous avons toujours soutenue sans attendre M. Santini, affirme Mme Le Strat, à la Mairie de Paris. Mais personne ne se prononcera à court terme sur un seul opérateur pour l'ensemble de l'Ile-de-France." La capitale a toujours veillé par le passé à défendre son indépendance en matière de politique de l'eau. S'en priver en rejoignant un Grand Paris de l'eau serait pour la Ville une révolution politique.